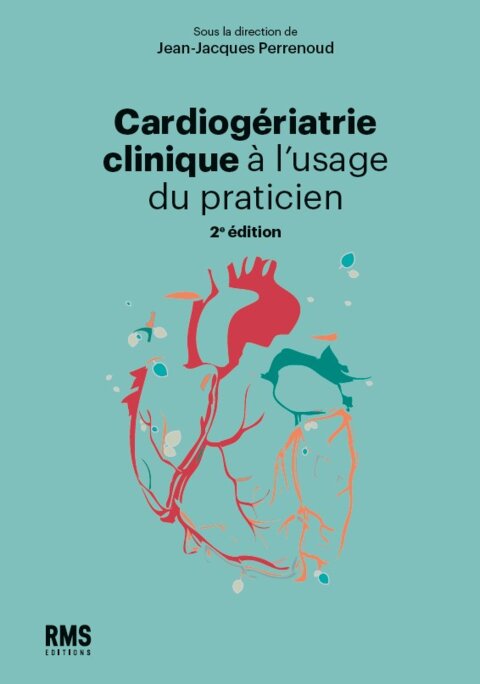Sommaire
00:00 Introduction et objectifs de la conférence
01:00 Définition des notions de sexe et de genre
03:00 Les différentes dimensions du genre
06:00 Sexe biologique : complexités et nuances
09:00 Paradigmes en recherche biomédicale : androcentrisme & naturalisme
14:30 Inégalités dans la recherche et essais cliniques
19:00 Exemples cliniques : maladies cardiovasculaires et biais de genre
26:30 Tabagisme et marketing genré
30:00 AVC et construction d’un score de genre
34:00 Douleur : différences biologiques, sociales et stéréotypes
40:00 Études expérimentales sur la douleur et biais de genre
43:00 Cumul des discriminations en santé
45:00 Biais implicites et test Harvard
47:00 Stéréotypes en formation médicale
50:00 Pistes d'amélioration en enseignement et recherche
52:00 Conclusion & ressources pour aller plus loin
Résumé
La conférence explore les impacts du sexe biologique et du genre socioculturel sur la santé, en mettant en lumière leur interaction dans la pratique médicale. Le sexe est défini par des critères biologiques (chromosomes, hormones, anatomie), tandis que le genre englobe les rôles, identités, comportements et relations socialement construits. Ces dimensions influencent la présentation clinique, la prise en charge, et les résultats de santé.
La médecine a longtemps été fondée sur un paradigme androcentré, prenant l’homme comme norme universelle. Cela a engendré une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques, en particulier en pharmacologie, menant à des biais dans les traitements et une fréquence accrue d’effets secondaires chez les femmes.
Des études suisses ont montré que les femmes hospitalisées pour un syndrome coronarien aigu reçoivent moins souvent des traitements invasifs, sont admises plus tardivement et présentent une mortalité intra-hospitalière plus élevée, en particulier chez les femmes jeunes. Des biais de genre sont également retrouvés dans la prise en charge de la douleur, avec une tendance à sous-traiter les femmes ou à attribuer leur plainte à des causes psychogènes.
L’exposé présente également des recherches novatrices intégrant un score de genre, tenant compte des rôles sociaux (profession, parentalité, revenus, etc.), et révélant que la non-conformité aux normes de genre peut influencer la reconnaissance des AVC.
Enfin, la Pre Clair souligne l’importance de la formation des professionnel·le·s à l’analyse critique des stéréotypes et des biais implicites, ainsi que l’intégration systématique du sexe et du genre dans la recherche biomédicale, afin d’améliorer l’équité en santé. Elle plaide pour des outils pédagogiques simples (checklists, cas cliniques mixtes) et une approche interdisciplinaire incluant les sciences sociales.